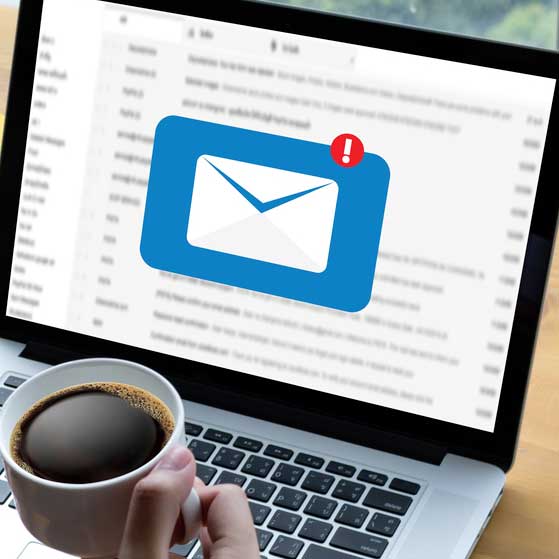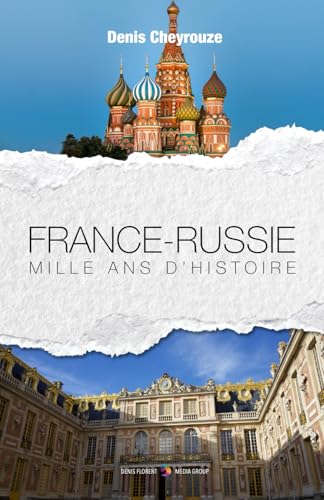En 2026, des accusés criminels pourraient être remis en liberté non pas parce qu’ils sont innocents, ni même parce qu’ils ont purgé leur peine, mais parce que la justice française n’aura tout simplement pas réussi à les juger à temps.
Le constat n’émane ni d’un polémiste ni d’un responsable politique en campagne, mais de magistrats eux-mêmes, procureurs généraux en tête, décrivant une machine judiciaire arrivée au point de rupture.
Une justice au bord de l’asphyxie
Les chiffres donnent le vertige. Des délais de jugement qui s’étirent sur plus de six ans pour certaines affaires criminelles. Des centaines de dossiers en attente devant les cours d’assises. Des audiences saturées pour plusieurs années à l’avance. Et, au bout de cette chaîne engorgée, une conséquence mécanique : la libération de détenus pourtant mis en examen pour des crimes graves, parce que les délais légaux de détention provisoire arrivent à expiration.
Ce n’est pas une hypothèse abstraite. À Aix-en-Provence, le procureur général évoque déjà plusieurs dizaines d’accusés concernés dès 2026. À Paris, la procureure générale parle d’un phénomène inévitable. Les mots sont choisis, mais le message est brutal : l’institution ne suit plus.
Le dogme bureaucratique contre la réalité
Depuis des années, la justice est administrée comme une simple direction ministérielle, soumise aux mêmes logiques comptables que n’importe quel service public. Réformes successives, empilement de procédures, complexification permanente du droit pénal, inflation normative : tout concourt à ralentir la machine.
À cela s’ajoute l’explosion de la criminalité organisée, des affaires tentaculaires, des procès fleuves mobilisant pendant des mois magistrats, greffiers, avocats, policiers, experts et salles d’audience introuvables.
Le résultat est prévisible : plus les dossiers sont lourds, plus le système est lent ; plus il est lent, plus il libère ceux qu’il n’a pas eu le temps de juger.
Une impuissance d’État assumée
Ce que révèle cette situation, c’est moins une crise ponctuelle qu’un choix politique de long terme. On légifère beaucoup, on communique davantage, mais on refuse de trancher.
Former massivement des magistrats ? Construire des juridictions adaptées ? Simplifier réellement les procédures ? Revoir la hiérarchie des priorités pénales ? Autant de décisions coûteuses, impopulaires ou politiquement risquées, donc soigneusement évitées.
À la place, on préfère bricoler : création de nouveaux parquets spécialisés, annonces de futures lois pénales, commissions, rapports, colloques. Pendant ce temps, les dossiers s’empilent et les calendriers judiciaires débordent.
Les citoyens comme variable d’ajustement
Dans cette mécanique absurde, une constante demeure : ce ne sont ni les délinquants ni les institutions qui paient le prix immédiat du dysfonctionnement, mais les citoyens ordinaires.
Ceux qui vivent dans les quartiers touchés par la violence. Ceux qui subissent cambriolages, agressions, trafics. Ceux qui entendent expliquer, demain, que tel individu est sorti non parce qu’il est blanchi, mais parce que l’État n’a pas su organiser son propre système judiciaire.
La promesse républicaine de protection se dissout alors dans un jargon administratif où « stocks de dossiers » et « contraintes procédurales » remplacent la sécurité concrète.
Une faillite qui ne dit pas son nom
Libérer des accusés criminels faute de pouvoir les juger n’est pas un accident technique, c’est un aveu d’impuissance souveraine.
Un État qui ne juge plus à temps est un État qui renonce, silencieusement, à l’une de ses fonctions premières : garantir l’ordre public.
Et lorsque la justice n’est plus capable d’exercer cette mission élémentaire, ce n’est pas seulement une institution qui vacille, c’est l’idée même d’autorité qui se dissout.